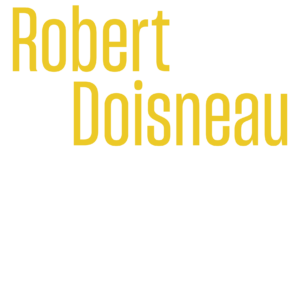Introduction
Introduction
Nous vous souhaitons la bienvenue dans l’exposition “Instants donnés, une rétrospective de l’œuvre de Robert Doisneau” créée par l’Atelier Robert Doisneau et Tempora. Au gré de votre déambulation, vous allez découvrir une dizaine de thématiques chères à Robert Doisneau. Pour découvrir l’œuvre et comprendre le chef d’œuvre, c’est le photographe lui-même qui, dans une simplicité qui lui est propre, commente ses clichés.
“J’ai réussi, mettons 300 photos…au maximum…300 photos qui résistent au temps…300 photos au 100ᵉ de seconde, ça fait jamais que trois secondes de réussite en 50 ans. Je n’ai pas lieu de pavoiser”.
Mis bout à bout, cela donne trois secondes d’éternité.
Parmi les 450 000 négatifs, près de 400 images ont été sélectionnées pour l’exposition. Une trentaine sont commentées dans cet audioguide. Nous vous souhaitons d’accueillir avec bonheur et curiosités ces instants magiques. Robert Doisneau vous les offre sans aucune retenue car comme il disait :
“C’est agréable de donner !”

Rolleiflex
Le Rolleiflex
“À l’époque, c’était le Rolleiflex qui était l’appareil dont on avait tous envie.(…) et à qui j’ai été fidèle longtemps. Et à tel point que quand je me suis débarrassé de ce premier engin, il n’y avait plus de vernis noir. J’ai appris ça depuis. Quand vous entrez dans une cage à lion, le dompteur vous dit : “N’ayez pas peur parce que si vous avez peur vous transpirez. Et il sent l’odeur de cette transpiration et il va vous… enfin vous agacer un peu”. Et cette transpiration qu’on a quand on a peur… Et quand on fait des photos, on a de temps en temps des angoisses comme ça, et bien ça détruit le vernis des appareils. (…) Et plus on a la trouille, plus l’appareil est blanc. (…) Je l’ai gardé très longtemps : Il était arrondi partout parce que les mains l’avaient usé.”

Les frères, rue du Docteur Lecène
Les frères, rue du Docteur Lecène
Parce que la poésie et la spontanéité sont au fondement de sa vision du monde, Robert Doisneau s’est senti proche de l’enfance tout au long de sa vie. Au début parce qu’il se dit timide. Ensuite, parce qu’il est reconnu parmi les enfants comme un des leurs. Il saisit l’enfance comme un film composé de petites séquences soutenues par des photographies solidement construites :
“Moi j’ai un dada qui est toujours le même. J’ai prétendu un jour qu’une image, pour être bien lisible, doit avoir la forme d’une lettre de l’alphabet un le V , le A , le O, le I, le L, enfin tout ça, c’est une idée. Un dada. J’ai dit ça un peu pour agacer. Oui…oui, mais enfin c’est pas mal quand ça se compose d’une façon géométrique”
Les acrobaties des frères de la rue du Docteur Lecène ne sont-ils pas comme deux lettres qui se suivent ?

Les cœurs à la craie de Ménilmontant
Les cœurs à la craie de Ménilmontant
Cette série des cœurs à la craie est emblématique de la volonté de Robert Doisneau de se rapprocher du cinéma, un art qui le fascine. Créer des séquences demande patience, observation et même obstination.
“Pour le cinéma, il faut avoir de l’autorité ! Il faut être sûr, il faut avoir des certitudes…puis pouvoir agir sur une troupe. Moi, je ne peux pas faire ça. Et puis, en plus, j’ai honte quand je travaille. Voilà. On ne peut pas me…On me dit toujours “Oh je voudrais vous accompagner dans Paris, C’est tellement amusant”. Oh là là, Si vous me voyiez faire ! J’ai honte – d’abord honte de rester sur place parce que…J’ai l’air d’hésiter, mais j’hésite…en réalité. Je ne sais pas ce que j’attends…mais j’attends. J’attends. J’ai l’espoir. Et alors…avoir un témoin de ces hésitations, de ces retours en arrière, d’aller dans une rue, revenir sur ses pas et de repartir quelques minutes après. Si j’avais un témoin, mais bon, je ne voudrais pas devant quelqu’un…non…ça me paralyse.”

14 juillet, rue des Canettes
14 juillet, rue des Canettes
Cette série montre la manière avec laquelle le photographe s’intègre à la foule lui permettant de photographier au plus près les enfants, leurs jeux et leurs parents.
“Plus je suis fondu, plus je suis content. En plus, c’est même une attitude philosophique. Je ne veux pas être un observateur froid, scientifique. Je veux être fondu : laisser les gens autour de moi…comme ça. La foule, ça me fait peur. Mais les individus semblables, c’est cela que je mets. Dans le fond, j’essaie de faire ma photo pour ne pas mourir.”
Car pour Robert Doisneau, photographier est une manière d’arrêter le temps qui passe, même s’il gagne toujours. Il a immortalisé pourtant ce moment, celui de la fête du 14 juillet, dans cette rue se trouvant à Saint Germain-des-Prés en 1949.

Ateliers d'artistes
Ateliers d'artistes
Les ateliers sont un environnement naturel pour Robert Doisneau. C’est un lieu divin où l’idée devient œuvre, où la main et l’outil sont guidés par la pensée créatrice.
“Quand je vais chez quelqu’un, il est sûr que cinq minutes après, on se retrouve dans…Si c’est un peintre dans l’atelier, si c’est un écrivain autour de sa table. Je suis toujours près des outils. Ça me plaît. Vraiment, non… C’est là qu’il y a vraiment le mérite…La vie.”

Les pains de Picasso
Les pains de Picasso
Photographier les artistes va au-delà de la technique : c’est mobiliser plus des talents de metteur en scène et de joueur comme il le fit avec Picasso.
“Mais c’était sur la nappe. Il y avait les deux pains en forme de main. Or il a suivi mon regard. Puis il m’a dit “Oui, mais c’est le boulanger de Vallauris qui fait ça. Et quand je lui ai signalé qu’il n’y avait que quatre doigts, il m’a dit : “Alors je les appelle des Picasso”. Alors j’ai mis les deux pains à côté de l’assiette et il a fait tout de suite le geste que je souhaitais le voir faire, c’est-à-dire mettre les bras le long de la table avec les pains en prolongement qui faisait les mains. Et à partir de ce moment-là, j’avais compris le jeu : il fallait lui proposer des accessoires et tout de suite il improvisait quelque chose. Je suis resté juste deux jours avec lui et en deux jours j’ai fait une provision de photos, peut-être 20 photos différentes de gags comme ça. C’est vrai, il aimait bien.”

Giacometti
Giacometti
“Giacometti c’était quand même… Alors pleins de mégots de cigarettes par terre, de pâquerettes par terre comme ça..Et lui se pétrissant le visage, en disant “Oh, pas ce matin, non, vous n’allez pas le faire ce matin. Regardez la gueule que j’ai !”. Il se frottait le visage. Et puis au bout d’un moment : “Allez on va prendre un café rue d’Alésia. Alors on sortait et on revenait après. Et l’atelier était, vous savez, cette poussière de sculpteur, qui est du plâtre sale, ça donne une patine, une unité à tout ce qu’il y avait dans l’atelier : les ébauches, la table avec tous les godets…Tout ça, c’était recouvert de cette même poussière grise. Et ça, c’était vraiment fait pour un photographe qui fait du noir et blanc.”

Publicités
Publicités
Robert Doisneau a, dès la sortie de sa formation, l’occasion de créer des publicités, notamment à l’atelier de la marque pharmaceutique Uhlman. Lorsqu’il est employé chez Renault, entre 1934 et 1939, sa pratique doit s’adapter notamment pour les présentations de véhicules aux premiers salons de l’automobile. Il commente les deux étonnantes photographies d’une voiture sans carrosserie :
“Du temps où j’étais chez Renault, la publicité était formidablement ringarde. Alors quand il y avait à faire des photographies, pour le salon, montrant l’aisance à l’intérieur d’une voiture, le confort, comme la carrosserie n’était pas prête, nous faisions ces photos-là à l’intérieur du studio, les gens assis par terre avec une direction bidon, et puis, tout le monde très décontracté : c’était des gens du service, c’était pas des modèles, des mannequins”.
Il réalise également des photographies avec des mannequins mis en scène dans des voitures luxueuses et des lieux agréables tels le Parc de Saint-Cloud. L’entreprise continuera de le solliciter après son départ. La marque Simca fait aussi appel à ses services dans les années cinquante et soixante. Plus largement, créer des publicités pour toutes sortes de produits faisait partie du quotidien du travail à l’agence.

L’atelier de Robert Doisneau
L’atelier de Robert Doisneau
L’atelier de Robert Doisneau était intimement lié à la vie privée. Logé dans un atelier d’artiste de Montrouge, il combine vie familiale et matériel technique dans une délicate alchimie, l’un alimentant l’autre.
“Ah, mon premier laboratoire, c’est une baignoire, bien entendu. Une baignoire de salle de bain. Bien sûr, avec mes deux petites filles qui disaient :”Papa, il faut, il faut que je prenne un bain”. Alors on rangeait tout et ces enfants se trempaient dans un mélange d’eau de la ville et un peu d’hydroquinone probablement.”
Toutefois l’atelier Doisneau c’est aussi de multiples inventions, des collages et des compositions étonnantes qui se détachent du seul appareil photo. Plus que l’outil, c’est le regard qui compte.

Face à l’œuvre
Face à l’œuvre
Robert Doisneau s’intéresse à l’art mais davantage encore, à ce qu’il suscite comme réaction chez les visiteurs.
“Quand on me parle de chasseurs d’images, ça me fait tout doucement rire parce que je suis pas un chasseur d’images, je suis un pêcheur d’images. Et dans le cas du tableau dans la vitrine, c’est pas la pêche au lancer où on court après la truite, non, c’est la pêche au coup. C’était en 47 je crois et ça faisait un peu scandale.
Cette dame au bas noir montrant son derrière et vue de l’intérieur de la boutique, on voyait se succéder des gens qui étaient assez souvent scandalisés. Et puis il y a eu un couple qui est venu. La dame était très intéressée devant le profil d’un vase qui était devant elle et regardait le vase avec intérêt. Et le monsieur avait un regard très très oblique du côté du côté, comment, convexe de la dame.
Il a le regard oblique et finalement, c’était ça qui m’intéressait. Mais c’est de la chance”

La mode
La mode
“J’étais pas fait pour faire de la photo de mode. Parce que je m’en fiche complètement. Il y a deux choses qui m’ennuient terriblement : c’est un défilé de mode et le pesage de Longchamp Porte d’Auteuil. Ce sont des gens qui m’ennuient, qui ont l’air de suer l’ennui. C’est la fausse valeur, oh la la, ça c’est vraiment pénible pour moi. C’est l’enfer.
Le De Bruneau, c’était un homme très très charmant. Il me disait : “Allez voir le défilé chez Dior et dites-moi quelles sont les robes qui vous inspirent. Et au 4e mannequin, j’avais complètement perdu le contact avec l’intérêt du défilé.
Et le lendemain, Michel de Brunhoff me disait : “Alors quelle robe ? ”. Je disais au hasard comme si je faisais un quarté. Le 13, le 17, le 23 et le 34. Paf. Et dans le studio arrivaient le 13, le 17, le 23 et le 34.”

Les années Vogue
Les années Vogue
“Les gens qui ne foutent rien sont très beaux…Vous pensez : ils passent leur temps dans la baignoire, ils sont brossés, astiqués…et puis bien habillés en plus, les femmes sont très très belles dans ces grands bals où j’allais faire des photos…acrobatiquement…parce que c’était pas facile à faire… mais j’étais le fils du jardinier invité à jouer avec les enfants du château quoi ”.
Pourtant Robert Doisneau a du succès dans cette mission qui couvre la reprise de la vie culturelle parisienne, la mode et les événements mondains. Son travail est conduit avec professionnalisme et rigueur. Dans ce contexte exotique à ses yeux, il retrouve ses habitudes et, par exemple lors d’un grand mariage à Paris, il suivra une petite fille plutôt que les célébrités. De même, dans les ateliers, il se rend au chevet des ouvrières aux mille et unes petites mains qui fabriquent ces spectacles mondains et culturels.

Sur la critique
Sur la critique
“J’avais parfois l’impression de trahir un petit peu, le choix que j’avais fait au départ. Et puis, il y a tout de même une chose, le devoir de faire le bouffon dans ce cas-là. C’est-à-dire de se moquer un tout petit peu de ce milieu. Ces fées carabosses de la mode, ces espèces de mères fouettardes qui décident qu’une collection est nulle ou qu’elle est sublime. Il n’y a pas de milieu, vous savez : on donne toujours des adjectifs. Des teignes. Et…ces bonnes femmes sont vraiment épouvantables, ça c’est terrifiant. C’est un monde d’une cruauté, une inélégance justement, une impudeur. Alors, là il faut choisir le mot : elles sont laides”.

Les bals
Les bals
“Le premier bal que j’ai été amené à photographier, j’avais rencontré Monsieur Etienne de Beaumont à Vogue l’après-midi, dans le bureau de Edmonde Charles-Roux. C’était un vieux monsieur à cheveux blancs, avec sa voix distinguée, nez assez grand, rose de chair comme on l’est sur les toiles du XVIIIe.
Il m’a dit : “Et bien pour ce soir, venez donc avant nos invités. Bon il allait donner un grand bal dans son hôtel particulier. J’avais un assistant qui était Maurice. Maurice et moi-même nous sommes partis en galopant au Cor de chasse, où on loue des smokings. Et la dame du Cor de Chasse nous a dit :
– “Revenez mardi, vous aurez vos dimensions..
– Non, non Madame, on part tout de suite avec.
– Mais vous ne pouvez pas”.
– Mais si…avec des épingles à nourrice”.
Alors on est arrivé dans le hall de son hôtel, bourrés d’épingles à nourrice pour que les manches ne soient pas trop longues et les jambes également. On avait deux musettes de l’armée américaine pleines de flash parce qu’à l’époque les flashs ne duraient qu’une seule fois. C’était des ampoules.
Et alors Etienne de Beaumont était sur les marches de l’escalier. On entre tous les deux dans le péristyle, les deux pingouins, mais grotesques vraiment comme ça. Il nous regarde, il nous dit : “Messieurs, vous allez être les rois de la soirée” . Donc voilà un homme qui avait de l’esprit !”

Ecrivains
Jacques Prévert au guéridon
Robert Doisneau a toujours été proche des écrivains, curieux de leur capacité à inventer des univers s’éloignant de la réalité.
“J’ai envie de raconter des histoires surtout. J’ai dessiné, j’ai fait comme tous les gens qui ont une formation un peu empirique, qui sont venus à la photo. J’étais d’abord graveur, je dessinais. Mais ce qui m’amuse le plus, les gens qui ont le plus d’influence sur moi, c’est peut être les écrivains et certains poètes, enfin comme ça, Mais pas poètes grandiloquents. Enfin des poètes qui parlent des choses que l’on voit chaque jour. Prévert par exemple, voilà.”
Pourtant photographier les écrivains est une prouesse.
“Les gens les plus redoutables à photographier, ce sont des écrivains parce qu’ils n’ont pas de gestes physiques. Un peintre, un sculpteur…Oui, on le met dans son atelier. Boum ! Tout de suite il a l’automatisme, de l’attitude. Mais un écrivain, c’est pas facile. Ha c’est abstrait !”
Son talent lui permet de créer des décors suggérant délicatement certains traits de leur œuvre et de mettre en scène des personnalités uniques brossant cinquante ans de littérature et entrant dans des dialogues au long cours avec certains d’entre eux comme Cendrars, Giraud ou Prévert.

Robert Giraud
Robert Giraud
“Giraud, c’était mon copain de la nuit. Qui n’a pas assez écrit dans sa vie. (Le vin des Rues c’était, voilà) Giraud…à ce moment-là travaillait dans une galerie de la rue de Seine. J’avais fait sa connaissance dans cette galerie. Il m’avait invité à venir voir des personnages extraordinaires. Et c’était un moment où j’avais pris la résolution de faire que des gens dans le quotidien tout à fait moyen, sans, sans pittoresque.
Et, je tombe sur Giraud qui m’a emmené voir des gens tatoués des pieds jusqu’à la tête, un type qui élevait des fourmis dans une cave pour faire, pour recueillir des œufs, pour nourrir des faisans, enfin des trucs vraisemblables… Et Giraud est resté mon ami. Enfin..un frère…absolument.”

Blaise Cendrars à Aix-en-Provence
Cendrars sous la lampe
“J’ai été le voir à Aix-en-Provence, j’ai attendu trois jours et puis je l’ai trouvé en train de se faire raser dans un coiffeur, chez un coiffeur, où moi je me faisais couper les cheveux, ne sachant plus quoi faire de moi. Et puis quand l’homme à la serviette blanche s’est levé, il n’avait qu’un bras, c’était lui.
Alors j’ai été faire des photos de lui dans le vieux Aix. C’était bien.
Puis après on était chez lui aussi, où il travaillait face à un mur avec un papier devant l’ampoule nue pour ne pas se blesser les yeux. Et il avait une veste, une doublure de dufflecoat comme ça sur le dos. Il crevait de froid dans son truc. C’est là qu’il a écrit les premiers bouquins d’après la guerre L’homme foudroyé.”

Bistrots
Rue Lacépède, Vème arrondissement
Robert Doisneau fréquente assidûment les bistrots de Paris et sa banlieue avec la complicité de Robert Giraud qui lui ouvre les portes. La plupart ont disparu aujourd’hui. Il a ses habitudes comme chez Fraysse mais il ne recule jamais devant la découverte de nouveaux lieux qui, comme de véritables êtres vivants, s’apprivoisent.
“Ici à Paris…Avant de faire une photo dans un café, je dois prendre l’équivalent d’une dizaine de litres de Beaujolais… Ça dure…pas le même jour bien entendu…. Je reviens jusqu’à ce que je fasse partie du décor. Que je sois fondu…Que je me sois fait des complices….Alors à partir de là, on peut commencer à espérer pouvoir faire une photo”.
La mère Guignard, le café Curieux, Chez Tourette, Aux chasseurs…autant de lieux où il assiste à des scènes invraisemblables et dont il raconte des anecdotes croustillantes.

Pierrette d’Orient
Pierrette d’Orient
“J’avais fait connaissance d’une très très jolie femme qui s’appelait Pierrette d’Orient. Et on était à Mouffetard avec Mérindol. J’entend une voix qui dit :
– “Est-ce qu’on peut chanter patron ?
– Oui..oui.. .Si vous voulez”.
Je vois une chanteuse, mais vraiment la séduction qui joue tout de suite. Elle était un peu méprisante : elle dominait son auditeur d’homme rabougri. Et elle chantait “Tu veux pas te figurer comme je t’aime, c’est si doux d’être câlinée”. Ah, c’était formidable. Alors elle a terminé sa chanson. J’ai été la voir, je lui ai dit :
– “Est-ce que ça vous ennuie si je fais une photo de vous”.
– “Non”
Alors j’ai mis discrètement un peu d’argent dans la soucoupe : ça a dû lui plaire. Et j’ai deux trois photos d’elle. En fait, la meilleure photo d’elle, que j’ai, c’est ce jour-là.
Et après, mon ami Giraud est venu, ce qu’il faudrait quand même faire : “A quel endroit vous allez ? Vous allez aux Halles. Et bien, les Halles ça nous intéresse”. Et alors, on la suivit aux Halles, chez les bouchers de la Villette. Les bouchers, les tueurs, plein de sang, qui pleuraient quand elle disait “Tu veux pas te figurer comme je t’aime”. Elle était formidablement belle.”

Mademoiselle Anita
Mademoiselle Anita
“Avant d’enlever son boléro, elle était plus anonyme. J’ai bien fait d’attendre, d’avoir l’audace : “Vous permettez que ? Oui” Et d’elle-même elle a enlevé son petit boléro. Alors là, la chrysalide s’ouvre, et le papillon apparaît.”

Gravités
Gravités
Des lieux de misère, des banlieues déshéritées que Robert Doisneau arpente enfant mais dont il saisit les caractères comme photographe avec une ferme détermination d’y trouver un merveilleux quotidien, même si…
“C’est-à-dire que c’est plus facile pour quelqu’un qui va extraire ce qu’il trouve beaux d’endroits où on ne pense que seule la banalité règne. Et c’est bien de révéler qu’il y a là des moments de beauté, de charme, d’exaltation possible. Oui.”
Et quand il s’exprime sur les modèles qu’il photographie, c’est au fond de lui qu’il parle.
“Dans le fond, je ne fais que des autoportraits, j’y suis. J’ai beaucoup de pitié. C’est parce que j’ai pitié de moi et que je m’aime bien tout compte fait, et que j’aime bien tous ces gens là et que ce petit moment de bonheur qu’ils ont volé dans leur vie, pourquoi ne pas l’immobiliser ?”
Face à ces portraits, Robert Doisneau opère comme un révélateur :
“Les gens transportent avec eux un trésor dont ils sont complètement inconscients. Alors on montre que ce trésor existe. A partir de ce moment-là, ils peuvent dire . “Ah oui, mais ça m’appartenait. Je ne savais pas que j’avais ce trésor avec moi”. Là, je révèle. Oui, je révèle le truc. Et ça, c’est mon rôle social de montrer l’évidence. C’est ça.”

Leica
Leica
Comme celle de tous les photographes, l’œuvre de Robert Doisneau est en positif, ce que l’on voit et, en négatif, ce qu’il a décidé de ne pas photographier. Photographier c’est s’appuyer et appuyer sur le bouton d’un fidèle compagnon de route : l’appareil photo.
“L’appareil photo est comme le casque pour le pompier, ça donne du courage.”
Pourtant parfois cet appareil n’est pas souhaité. Soit parce que le photographe refuse d’immortaliser des situations dégradantes.
“Il y a des choses qu’il ne faut pas faire. Par exemple la libération de Paris. Les femmes tondues, il ne fallait pas montrer ça. Enfin, ça existe. Oui, peut être, ça existe historiquement, mais c’était tellement laid, tellement lâche. Tous ces gens qui étaient…qui n’avaient rien foutu pendant l’occupation, qui se retrouvaient justiciers. Voilà, voilà encore le besoin d’être puissant d’être des justiciers.”
Ou encore parce que la présence n’est pas souhaitée.
“Je m’en vais. On ne peut pas insister ! Je ne vais pas faire le forcing ! Le pied dans la porte, c’est bon pour passer un aspirateur. Moi je ne passe pas un aspirateur !”
Ces situations sont toutefois rares car, de son propre aveu. Robert Doisneau est fondu dans son environnement.
“Parce que la plupart du temps, je vis dans des milieux qui me sont tout à fait familiers, où je suis toléré et connu même”.

Industries
Industries
“J’aurai dû faire à ce moment-là tout un travail sur le monde du travail, justement. Pendant que j’étais chez Renault, je ne pouvais pas du tout faire autre chose que ce qui se passait dans l’usine de Billancourt… 30 000 ouvriers, vous voyez, il y avait certains choix… Mais j’aurais dû faire un travail sur les conditions de vie des gens de la grosse sidérurgie, des mines, des pêcheurs. Enfin, tous ces travaux : les chauffeurs de locomotive par exemple, que j’ai connu par après. J’ai à chaque fois un peu égratigné le sujet mais sans profondément vivre plusieurs jours, plusieurs semaines avec ces gens. Je ne pouvais pas le faire parce qu’il fallait être, tout de même, avoir des moyens. Il fallait accepter des travaux alimentaires pour faire vivre la famille. Mais je n’ai peut-être pas eu la volonté, l’organisation, la méthode pour réussir ce travail.”

Banlieues, noir et blanc
Banlieues, Noir et Blanc
Que ce soit les “vingt ans de Josette”, le « vélo du printemps” ou “la petite terrasse”, ces photos des années cinquante en banlieue, Doisneau les a toujours pris avec une certaine retenue mais en mettant l’humain au centre de son objectif.
“La rue que j’avais connue étant enfant, à Gentilly. Je trouvais que j’aurais mérité un décor plus tendre et plus suave que celui dans lequel je me débattais. Et l’opposition entre le décor absurde, très laid de la banlieue parisienne, et les gens qui passent là-dedans sont par opposition avec le fond ; la tendresse des êtres apparaît beaucoup plus touchante. Et c’est ça que j’ai voulu montrer : dans le fond, c’était une espèce de grogne, de plainte.”

Banlieues, couleur
Mission DATAR, résidence de la Fosse aux Prêtres
Trente ans plus tard, il prend le contrepied en photographiant des image saturée où la vie semble s’être évaporée.
“Il fallait faire absolument de la couleur. C’est pas une humeur ou une tentative, ou une expérience pour moi. C’était absolument nécessaire. Cet élément nouveau qu’est la couleur est une documentation supplémentaire.”
Pour lui la couleur revêt de multiples dimensions.
“La banlieue que j’ai connu était grise et bistre, avec des voitures noires. Et maintenant, il y a des voitures qui sont colorées comme un collier de perles en bas des grandes maisons et les maisons sont très colorées. Je pense que c’était une façon de faire la sauce qui fait passer le poisson. C’est tellement effrayant. C’est les dimensions de ces bâtiments qu’on leur fout des couleurs. C’est un maquillage. Je ne sais pas, c’est pas une décoration. Quand on les maquille pour les rendre aimables.”

La concierge aux lunettes
La concierge aux lunettes
Un regard de face, une juste distance permettant de distinguer le sujet et la force des expressions, un cadrage impeccable…Il n’en fallait pas plus pour que cette concierge prise à Paris en 1949 et publiée dans le magazine Vogue devienne un icône. Cette concierge est-elle bien réelle ?
“Ça n’existe pas. La réalité, ça n’existe pas. On se fait la réalité. Rien que le fait de choisir l’instant qui vous arrange en face, on arrange la réalité. C’est très..C’est pas du tout réel, c’est complètement fabriqué, nos histoires. On intervient pas en bougeant les personnages, mais on les choisit dans le temps et dans l’espace. On se met à un tel endroit ou ça vous arrange. Donc…c’est…c’est une espèce de faux témoignage…ah oui…Mais on se sert de matériaux vrais, ça c’est c’est bien. Ça donne une solidité. Mais on y croit comme ça.”

Pastel pitoyable
Pastel Pitoyable
Un prêtre piétinant des anges sans se retourner forme une scène amusante qui conduit à se demander comment le photographe a provoqué cette étonnante interaction.
“C’est important le hasard. Toutes les rencontres heureuses que j’ai fait dans ma vie, c’est le hasard qui me les a fournis. “Au bout de 2 h d’attente, peut-être moins. Mais 2h, c’est le maximum. Je ne peux pas faire plus. Parce qu’après l’attention se relâche, on devient moins réceptif. Et c’est à ce moment là que… le petit Dieu malin vous envoie une scène qu’on n’a pas prévue. Je me fais un petit décor, un rectangle et j’attends que dans ce rectangle, des acteurs viennent jouer je ne sais pas quoi. Alors l’imagination fonctionne. Il arrive tout autre chose. Et c’est pas bon d’attendre une chose précise. Autrement dit, le..le photographe plein de références ne va faire que d’illustrer ses références.”

L'enfer
L'enfer
Robert Doisneau considère que la désobéissance est une condition de la photographie. Il a une aversion pour l’autorité et pour ses représentants.
“L’ennemi de l’image photographique, c’est d’abord le ferrocyanure de potassium, parce que ça détruit l’image argentique. Et au même titre que le képi, le képi. “Circulez, y a rien à voir”. Mais il faut s’arrêter et regarder ! ”
Avec cette image pêchée, au coin d’un trottoir depuis son poste d’observation, il envoie cette marque d’autorité en enfer ouvrant enfin sur le paradis de la liberté totale de photographier.

Le Baiser de l'Hôtel de Ville
Le baiser de l'hôtel de ville
“Il y a des tas de gens qui revendiquent d’avoir été les amoureux de l’Hôtel de ville. Et en réalité, il n’y a eu que deux personnes. Mais j’en ai, j’ai quinze, vingt – non c’est un nombre pair – huit, dix postulants. Non, non, cette photo m’inquiète un peu : ce succès montre que c’est une chose très très facile, un effet facile. Et ce qu’il y a c’est, que je pense, pourquoi tant de gens s’identifient : c’est parce que c’est quand même une, un espèce de symbole d’un moment heureux. C’est ça. Alors ils auraient aimé être là, et de là à penser que c’était eux, il n’y a qu’un pas”.
Crédits Audioguide
INA Archives